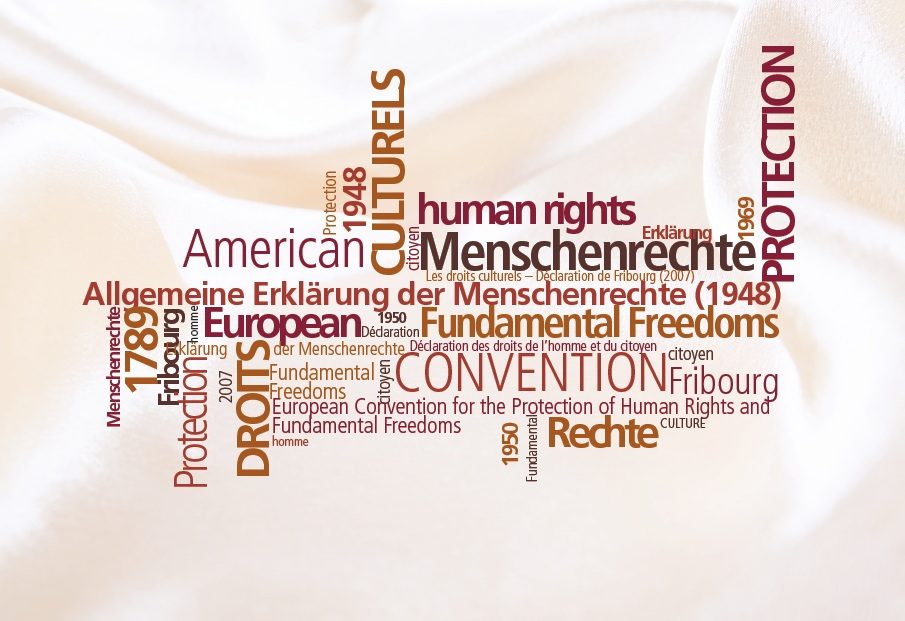Nous étions les 7 et 8 février à la Gare Franche pour échanger sur les droits culturels à l’occasion du séminaire « Patrimoines et biens communs au regard des droits culturels », organisé dans le cadre de Paideia, une démarche d’observation et d’évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels.
C’est un référentiel dont on entend de plus en plus parler. Consacrés dans de nombreux textes internationaux et notamment dans la Déclaration Universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, les droits culturels se rattachent aux droits fondamentaux de la personne. Depuis l’été 2015, ils sont reconnus juridiquement dans la loi française[1] et offrent de nouvelles perspectives quant à la manière de penser l’action culturelle et artistique. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de s’approprier facilement cette notion au centre de nombreuses discussions et recherches, aussi bien à l’échelle des collectivités territoriales qu’au niveau des porteurs de projets.
Le travail de recherche-action mené par le Réseau culture 21, en collaboration avec L’Institut Interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de l’Université de Fribourg propose des outils et des ressources sur lesquels les acteurs peuvent s’appuyer pour poursuivre la réflexion sur les manières de construire les projets culturels et artistiques en prenant en compte les droits fondamentaux de la personne. En effet, depuis fin 2012, trois recherche-actions thématiques ont été menées avec plus de 10 départements français sur la création, le pouvoir d’agir et le bien commun. Elles ont permis de collecter plus de 250 cas d’école qui ont abouti au développement de propositions pour faire évoluer les pratiques.
Au cours du séminaire des 7 et 8 février derniers, nous avons pu découvrir et analyser collectivement des démarches patrimoniales originales qui se sont développées dans le respect des droits culturels. A titre d’exemple, citons les balades urbaines d’Hôtel du Nord autour du patrimoine des 15e et 16e arrondissements de Marseille, le projet d’action culturelle du service d’archéologie de la Ville de Saint-Denis, ou encore le travail de Lieu Fictif autour des images d’archives et de la création cinématographique en milieu carcéral. En analysant ces cas d’école, nous avons pu croiser nos expériences et questionner nos méthodes de travail et nos outils d’évaluation.
Aux Têtes de l’Art, nos principes directeurs rejoignent l’horizon d’action des droits culturels : la diversité culturelle, les processus participatifs et la transversalité de la culture. Il semble qu’en tant que porteur de projet, nous ayons chacun un rôle à jouer pour lui donner corps et épaisseur, le questionner, le faire évoluer afin qu’il soit demain un terrain incontournable pour penser l’action culturelle.
Pour en savoir plus, sur les droits culturels et la démarche de Paideia :
– La banque de cas d’école de Paideia
– Les publications de Paideia
– Site du réseau Agenda 21 de la culture
– Espace ressources du Réseau culture 21

[1] Voir l’article 28A de la loi NOTRe du 16 juillet 2015 et l’article 2 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la loi de Liberté de Création, d’Architecture, et de Patrimoine.